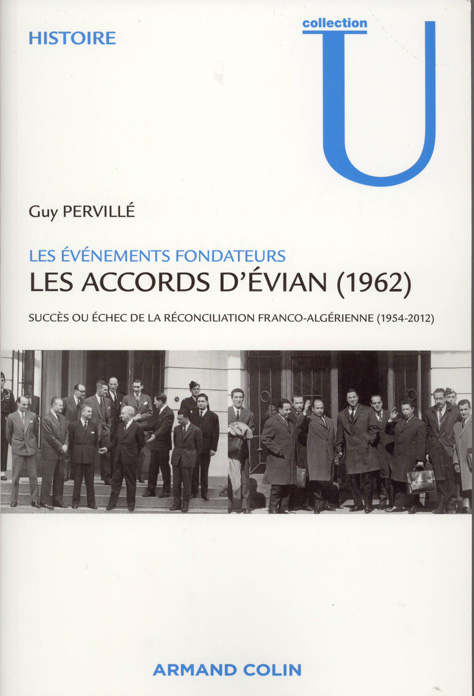Les accords d’Evian (1962). Succès ou échec de la réconciliation franco-algérienne (1954-2012) (2012)
lundi 10 septembre 2012.Vient de paraître : Guy Pervillé, Les accords d’Evian (1962). Succès ou échec de la réconciliation franco-algérienne (1954-2012). Paris, Armand Colin, Collection U, Histoire, "Les événements fondateurs", septembre 2012, 288 p. ISBN 978-2-200-24907-6
Ce livre reprend, complète et surtout met à jour le livret illustré d’extraits de presse que son auteur avait publié il y a vingt ans dans la collection de la Documentation française intitulée "Les médias et l’événement", aujourd’hui disparue. Partant de l’événement du 18 mars 1962 (signature des accords d’Evian destinés à mettre fin à la guerre d’Algérie), il remonte davantage vers les origines de la négociation entre la France et les chefs du nationalisme algérien, et montre même pourquoi ces négociations étaient impensables, dans l’esprit des dirigeants français, avant 1955. Mais aussi et surtout il s’intéresse aux suites et aux conséquences de cet événement en allant jusqu’à une histoire immédiate ou presque immédiate (premier semestre 2012). Ainsi ce livre, qui n’a pas d’équivalent, nous présente une première esquisse de l’histoire des relations toujours difficiles entre ces deux partenaires, la France et l’Algérie.
|
Couverture Accords Evian |
Entre 1954 et 1962, la politique algérienne de la France évolua très rapidement, du principe de l’intégration croissante de l’Algérie dans la métropole à la recherche d’une négociation sur l’autodétermination de ses habitants et la définition de nouveaux rapports entre deux Etats indépendants.
Les négociations entreprises en 1961 entre le gouvernement français et le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA) représentant le Front de Libération Nationale (FLN) aboutirent aux accords d’Evian du 18 mars 1962. Mais leur application tourna très vite au démantèlement de ces accords, et dans le demi-siècle qui suivit toutes les tentatives de relance de relations exemplaires entre l’Algérie et la France ont abouti à des désillusions. Pourquoi ? C’est ce que ce livre se propose de rechercher et d’expliquer.
Les accords d’Evian, qui mirent fin officiellement au mythe de ’l’Algérie française" et aboutirent en de longs mois chaotiques à la séparation de deux Etats, font bien partie des événements fondateurs de notre temps. Un demi-siècle après leur signature, il appartient à l’histoire de relayer des mémoires trop sélectives.
Guy Pervillé, professeur émérite d’histoire contemporaine, travaille sur la politique algérienne de la France, la guerre d’Algérie, et les relations franco-algériennes, depuis plus de quarante ans.
 Table des matières :
Table des matières :
 Du même auteur, p. 3.
Du même auteur, p. 3.
 Préface, p. 5.
Préface, p. 5.
 Introduction : Evian, le 18 mars 1962, p. 6.
Introduction : Evian, le 18 mars 1962, p. 6.
 Première partie : des réformes aux négociations, p. 15.
Première partie : des réformes aux négociations, p. 15.
Chapitre 1 : Avant le 1er novembre 1954, p. 16.
Chapitre 2 : Du 1er novembre 1954 au 13 mai 1958, 33.
Chapitre 3 : De Gaulle et l’Algérie avant le 1er juin 1958, p. 46.
Chapitre 4 : De Gaulle et le problème algérien du 1er juin 1958 au 16 septembre 1959, p. 58.
Chapitre 5 : De Gaulle et le problème algérien du 16 septembre 1959 au 8 janvier 1961.
 Deuxième partie : Les négociations et les accords d’Evian, p. 87.
Deuxième partie : Les négociations et les accords d’Evian, p. 87.
Chapitre 6 : De Gaulle et la négociation avec le GPRA (8 janvier 1961-18 mars 1962), p. 89.
Chapitre 7 : Les accords d’Evian et leur accueil (février-mars 1962), p. 105.
Chapitre 8 : De Gaulle et l’application des accords d’Evian (19 mars-20 septembre 1962), p. 117.
 Troisième partie : Un demi-siècle de relations franco-algériennes (1962-2012), p. 145.
Troisième partie : Un demi-siècle de relations franco-algériennes (1962-2012), p. 145.
Chapitre 9 : De Gaulle et la remise en question des accords d’Evian (1962-1969), p.147.
Chapitre 10 : Les relations franco-algériennes, entre ruptures et rapprochements (1969-1991), p. 189.
Chapitre 11 : La France et la crise algérienne (1992-1999), p. 208.
Chapitre 12 : La France et l’Algérie, un rendez-vous manqué (2000-2012), p. 231.
Conclusion : Cinquante ans après, les conditions d’une vraie réconciliation, p. 249.
Chronologie, p. 257.
Biographie des principaux personnages cités, p. 260.
Bibliographie, p. 271.
Principaux sigles utilisés, p. 279.
Index des noms de personnes, p. 281.
Table des matières, pp. 286-288.
 "Algérie, avant, après", par Jean Sévilla, Le Figaro-Magazine, 1er février 2013.
"Algérie, avant, après", par Jean Sévilla, Le Figaro-Magazine, 1er février 2013.
"Le 18 mars 1962, les accords d’Evian mettent fin à la guerre d’Algérie, mais pas au drame des pieds-noirs, contraints à l’exil et spoliés de leurs biens, ni à celui des supplétifs musulmans de l’armée française, emprisonnés, torturés et exécutés en Algérie, parqués dans des camps pour ceux qui ont pu traverser la Méditerranée.
Professeur émérite d’histoire contemporaine, spécialiste de la guerre d’Algérie, Guy Pervillé publie dans une collection universitaire une remarquable étude sur ces accords de 1962, où il montre que les garanties laissées à la France ont toutes été violées par l’Algérie, et où il explique pourquoi les relations entre les deux Etats, cinquante ans durant, sont restées tendues, et souvent conflictuelles. Ne se contentant pas de ce constat, l’auteur esquisse "les conditions d’une vraie réconciliation"".
 Et un premier compte rendu, sélectif mais approfondi, paru le 19 avril 2013 sur un site internet "A propos du livre de Guy Pervillé, Les accords d’Evian" :
Et un premier compte rendu, sélectif mais approfondi, paru le 19 avril 2013 sur un site internet "A propos du livre de Guy Pervillé, Les accords d’Evian" :
"Je n’ai pas pour habitude de chroniquer un livre que je n’ai pas lu entièrement mais je vais faire une exception pour cet ouvrage retraçant les relations franco-algériennes, depuis les premières tentatives de créer un Etat algérien indépendant sous le Second empire jusqu’à aujourd’hui. Comme le nom l’indique l’essentiel est consacré à l’après-19 mars 1962.
Le lecteur peut constater l’incroyable cynisme du général De Gaulle, qui déclarait ouvertement être favorable à l’indépendance algérienne avant 1958, pour finalement laisser penser le contraire lors de son arrivée au pouvoir. Un malentendu qui aura des conséquences désastreuses (notamment la création de l’OAS).
1962 sera une année de sang où les accords d’Evian seront délibérément violés. L’exode dramatique des Européens ruinera complètement le pays : l’Algérie sera en quasi-faillite les premières années de l’indépendance et ne tiendra économiquement qu’avec l’aide de la l’ancien colonisateur.
Les rapports furent parfois très tendus entre les deux pays, notamment lors la France intervint dans le conflit du Sahara occidental en 1977 et 1978 alors que l’Algérie soutenait le Front Polisario (l’auteur parle de « guerre froide » franco-algérienne).
Mais à vrai dire c’est surtout la dernière partie consacrée à la guerre civile des années 90 qui m’intéressait. La vieille propagande nationaliste algérienne, qu’on aurait pu croire anachronique et dépassée, sera réutilisée durant cette décennie sanglante de façon abusive : les islamistes comme les militaires se disaient héritiers des « glorieux moudjahidines » de la « guerre de libération », chaque camp dénigrant l’autre avec la mémoire coloniale...
L’attitude à adopter face au Front Islamique du Salut a divisé l’opinion algérienne : d’un côté les « éradicateurs » souhaitant une élimination totale des islamistes du champ politique, de l’autre les « dialoguistes » qui souhaitent un compromis avec une solution négociée. Pour les premiers c’est le FIS qui est seul responsable des violences, pour les seconds c’est l’Armée et le DRS qui entretiennent la guerre civile pour rester au pouvoir.
Je suis ici en désaccord avec l’historien qui renvoie dos à dos les deux camps. Il me semble que le déroulement des faits donne plutôt raison aux « dialoguistes », qui auraient évité un bain de sang à l’Algérie si leur solution avait été appliquée ! On imagine la situation en Tunisie si fin 2011 l’Armée avait fait un coup d’Etat pour empêcher Ennahda d’arriver au pouvoir. Nul doute qu’il y aurait eu une guerre civile du même type !"
L’auteur du compte rendu développe sur plusieurs paragraphes son argumentation critique, puis il conclut :
"Cela dit je suis d’accord avec la remarque sur la culture de la violence entretenue dans l’Algérie indépendante ; c’est un point que ni les « dialoguistes » ni les « éradicateurs » ne semblent admettre. L’historien et ancien membre du FLN Mohamed Harbi déclarait ainsi : « l’idéalisation de la violence requiert un travail de démystification. Parce que ce travail a été frappé d’interdit, que le culte de la violence en soi a été entretenu dans le cadre d’un régime arbitraire, l’Algérie voit resurgir avec l’islamisme les fantômes du passé ».
Blog-notes " Une opinion parmi d’autres" de Ludovic Yepez, compte rendu mis en ligne le 19 avril 2013. http://ludovicyepez.wordpress.com/2013/04/19/a-propos-du-livre-de-guy-perville-les-accords-devian/
- Un premier compte rendu d’historien a été publié dans la revue Vingtième siècle, revue d’histoire, 2013/3, n° 119, juillet-septembre 2013. :
 Pervillé Guy, Les Accords d’Évian (1962) : succès ou échec de la réconciliation franco-algérienne (1958-2012) , Paris, Armand Colin, « U, les événements fondateurs », 2012, 288 p., 29,40 €.
Pervillé Guy, Les Accords d’Évian (1962) : succès ou échec de la réconciliation franco-algérienne (1958-2012) , Paris, Armand Colin, « U, les événements fondateurs », 2012, 288 p., 29,40 €.
"La période étudiée (1958-2012) par Guy Pervillé va au-delà de la guerre d’Algérie, elle porte sur les accords d’Évian et leurs conséquences sur les relations entre la France et l’Algérie dans le temps long. Plus encore, l’auteur s’interroge sur le « retour de mémoire » de part et d’autre de la Méditerranée : les relations tendues, conflictuelles, le « rendez- vous manqué » (titre du dernier chapitre), sont une part essentielle de cet ouvrage.
Après 1969, les relations entre la France et l’Algérie ne sont pas au beau fixe ; elles s’apaisent sous les présidences de François Mitterrand et de Chadli Bendjedid, mais la cohabitation et les débats autour du Code de la nationalité en France, et le développement du terrorisme vont à nouveau tendre leurs relations. Guy Pervillé rappelle les contradictions d’une mémoire sans cesse rejouée, à laquelle il s’attache particulièrement : aspiration à la paix des jeunes contrebalancée par le rappel des martyrs algériens, dénonciations récurrentes de génocide perpétré par la France. La montée du Front islamique du Salut (FIS) qui remporte les élections municipales de 1990, freine les espoirs de libéralisation politique (réforme constitutionnelle en 1989) et économique, et marque le début d’une période de crise, au cours de laquelle la France reste neutre. Pour l’auteur, l’occasion d’une vraie réconciliation est passée. La guerre civile (1992-1997) apparaît parfois comme un rejeu : répétition de la guerre d’indépendance en Algérie selon certains (amalgame entre terroristes islamistes et harkis, par exemple), au point que la situation pousse à évoquer des causes plus profondes et l’échec du régime de 1962. En France, ce rejeu n’est pas absent : les partisans de l’Algérie française rappellent leurs positions traditionnelles et l’incapacité de l’Algérie à gérer un État, tandis que les anciens partisans de l’indépendance pointent les méfaits persistants du colonialisme. Ni les demandes de repentance, ni l’apaisement de la crise algérienne n’ont permis d’amélioration durable des relations : les propos du président Bouteflika lors de sa visite officielle en 2000 en France le montrent.
Guy Pervillé insiste sur le fait que les accords d’Évian étaient fondés sur l’amnistie qui ne peut, elle, effacer la mémoire. Une commission « Vérité et réconciliation » permettrait de faire « l’aveu véridique des faits ».
Cet ouvrage, destiné avant tout aux étudiants est un vrai manuel, avec les compléments indispensables : chronologie indicative, biographie des principaux personnages cités, bibliographie à la fois chronologique et thématique, mention de quelques sites Internet, et bien sûr liste des sigles et index des noms de personnes. À la fin de chaque chapitre, Guy Pervillé propose des documents parfois peu connus et accessibles."
Chantal Morelle (auteur du seul ouvrage comparable, mais néanmoins très différent : Comment de Gaulle et le FLN ont mis fin à la guerre d’Algérie. 1962, les accords d’Evian. Bruxelles, André Versailles éditeur, 2012, 282 p).
- A lire également sur le site Etudes coloniales (http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2012/12/29/26018610.html), la réaction de Michel Mathiot :
"Ce livre est à recommander à ceux qui désirent se faire une idée globale de l’histoire de l’Algérie, dans la moyenne durée, au seuil et au lendemain de son indépendance. La présentation chronologique en facilite l’accès aux néophytes, de par les qualités pédagogiques de l’auteur (qui publie ici dans la Collection U, bien connue des étudiants). Les spécialistes y trouvent des analyses récentes et fines - notamment sur la pensée du général De Gaulle - avec des citations non vulgarisées par ailleurs, et qui mettent en question des affirmations habituelles à l’emporte-pièce sur sa politique algérienne : "... Je n’ai jamais varié sur l’Algérie, dit-il à Raymond Tournoux le 2 avril 1962 (La tragédie du Général). Ce que j’ai décidé est conforme à l’intérêt national. Je n’ai jamais accepté l’intégration. Dès le 13 mai c’était net. Je n’ai pas changé. Bien entendu j’ai avancé par étapes. La politique est l’art des réalités. Dès le début de juin 58 j’ai dit ce que je pensais. J’ai dit aux Algériens : Vous êtes des Français à part entière. Evidemment, cela voulait dire que je leur donnais l’égalité des droits" (p. 142). Ou encore "On les a écrabouillés, jusqu’au moment où on en a eu assez, à ce moment on leur a dit de se débrouiller, ils ne se débrouillent pas" (p. 160, Comité des Affaires algériennes du 16 novembre 1962, tiré de M. Faivre, Les archives inédites de la politique algérienne). L’auteur fait référence à certaines sources jamais vraiment analysées comme par exemple les entretiens avec Peyrefitte qu’il qualifie de "témoignage le plus éclairant sur les relations franco-algériennes durant cette période [janvier 1963, juin 1965]. Le titre peut paraître réducteur car il ne rend pas directement compte des études sur la longue durée qui sont une des caractéristiques de ce livre, contrairement à ceux des mémorialistes qui s’attachent presque exclusivement à l’événementiel (causes immédiates) et non aux causes profondes. Guy Pervillé a sélectionné des textes en annexe de chaque chapitre. Il y en a bien d’autres mais ceux-là sont sans doute essentiels. Ce livre est à conserver dans sa bibliothèque comme exemple documentaire, car c’est une synthèse récente ; comme exemple formateur, car en histoire nous sommes tous des étudiants ; comme exemple "littéraire", car il se lit avec avidité. Je suis étonné que pas un seul lecteur d’Etudes coloniales n’ait jugé bon de produire un seul commentaire depuis deux ans.
Parvenu à un moment charnière de son analyse (la mort de De Gaulle) l’auteur pose la question de l’avenir, et cherche vainement la "réconciliation". Il revient sur "l’étonnant paradoxe du style gaullien" (p. 185). " Suivant les moments, suivant les auditeurs, l’expression de sa pensée pouvaient revêtir les formes et les fonds les plus divers, parfois contradictoires. ses lecteurs peuvent en retenir ce qu’ils veulent, pour voir en lui un froid calculateur ayant cyniquement sacrifié ses compatriotes français et français musulmans d’Algérie, ou bien au contraire un parfait réalise cherchant à sauvegarder des objectifs limités de nature économique et stratégique pour une durée limitée. Mais ces deux points de vue opposés se situent dans le court terme et laissent de côté la poursuite d’une réconciliation franco-algérienne à long terme, dont on ne sait toujours pas si elle sera réalisée un jour". De Gaulle est omniprésent dans le livre, ce qui peut laisser penser qu’il fut le seul responsable de l’exode des pieds-noirs. D’autres bien avant lui n’eurent rien à lui envier en la matière, bien au contraire".
M. Mathiot. Posté par M. Mathiot, dimanche 14 septembre 2014.
- Puis un bref compte rendu par le journaliste Frédéric Valloire dans Le Figaro-Histoire, n° 17, décembre 2014-janvier 2015, p 102 :
Les accords d’Evian (1962) par Guy Pervillé.
"L’auteur est l’un des meilleurs spécialistes de la politique algérienne de la France et de la guerre d’Algérie, en tout cas le plus objectif et le moins soumis aux humeurs du temps et des médias. Sur ce compromis signé le 18 mars 1962, Pervillé signe une mise au point enrichie de nombreux documents. Ce fut en réalité une "utopie juridique". A la place du cessez-le-feu, les mois qui suivirent ces accords furent en réalité les pires de la guerre. Pour tout savoir sur leur contenu, sur les négociations qui les précédèrent et sur leurs conséquences, un seul livre, celui-ci".
-Et ce compte rendu qui est paru sur le site Etudes coloniales le 29 août 2015 (http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2015/08/29/32555748.html) :
Guy Pervillé, Les accords d’Evian (1962). Succès ou échec de la réconciliation franco-algérienne (1954-2012), A. Colin, collection U, 2012, 288 pages.
"Les accords d’Evian ont souvent été vus comme scellant définitivement 132 ans de présence coloniale en Algérie et terminant huit années de guerre. Or, pour l’historien G. Pervillé, les accords d’Evian ne sont pas uniquement un point d’arrivée, mais sont surtout le début d’un nouveau départ entre le nouvel Etat et la France. Les nouvelles relations franco-algériennes représentent d’ailleurs la partie la plus importante de l’ouvrage. Après avoir évoqué la genèse de l’idée de nation algérienne, G. Pervillé rappelle que les autorités françaises de la IVe République et le FLN n’ont jamais abandonné l’idée de négocier dès janvier 1956. Interrompues avec les événements de mai 1958 et l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle, les négociations reprennent à partir de décembre 1960.
Les accords d’Evian, « un bien étrange document » (R. Buron)
Si la plupart des commentateurs se sont focalisés sur le non-respect des accords concernant le cessez-le-feu, le sort des supplétifs et les Européens d’Algérie, G. Pervillé nous rappelle que les 93 pages des accords d’Evian, signés le 18 mars 1962, « [sont] « un bien étranger document » [expression de R. Buron, un des négociateurs français], qui combinaient un accord de cessez-le-feu entre deux forces armées, (...), un accord politique (...) prévoyant d’acheminer par étapes le territoire français d’Algérie au statut d’Etat indépendant, et enfin un projet de traité entre deux Etats ».
G. Pervillé évoque les divergences entre le GPRA et les représentants français : la trêve demandée par la France comme préalable aux négociations, la représentativité exclusive des Algériens par le GPRA, le statut des Européens incompatible et en contradiction avec l’unité du peuple algérien, le problème du Sahara, territoire intégré ou non à l’Algérie et les bases militaires françaises à Mers-el-Kébir et au Sahara. Les réactions de la presse aux accords d’Evian sont évoquées allant des éditoriaux de La Nation française parlant « d’un cessez-le-feu qui aggrave la guerre » et la constitution « d’un dispositif guerrier où l’ennemi à battre, est constitué par un million d’Européen et deux millions de musulmans consciemment fidèles » à L’Humanité réclamant désormais « l’épuration des éléments fascistes de l’armée, de la police, de la justice et de la haute administration ».
Des accords mal respectés par les deux parties
L’ouvrage consacre toute une partie à la difficile application des accords d’Evian. L’OAS sabota les accords en multipliant les attentats contre les Musulmans et les forces de l’ordre. Le FLN « contourne » les accords d’Evian : si l’armée française perd 58 soldats dans des combats avec l’OAS, 32 pertes sont dues aux combats avec l’ALN dans les deux premiers mois du cessez-le-feu. De plus, l’ALN enlève 93 militaires et plus de 1 000 civils entre le 19 mars et le 2 juillet sans compter les massacres d’Européens à Oran. Les attentats du FLN ne cessent pas, puisque 380 attentats répondent aux attentats de l’OAS. Les anciens supplétifs et les élus sont victimes de représailles, contrairement aux déclarations de garanties des personnes. Le gouvernement français estime que l’exode des Français d’Algérie ne dépassera pas les 100 000 personnes par an pendant quatre ans. Cette estimation sera bien loin de la réalité, puisqu’en mai 1962, ce chiffre était déjà atteint... La France, elle aussi n’a pas respecté les accords d’Evian puisqu’elle ne veille pas à leur bonne application : l’armée reste cantonnée dans ses casernes ; les commissions mixtes fonctionnent mal ; les supplétifs et leurs familles menacés ne sont pas rapatriés massivement.
Les accords d’Evian mettent au grand jour les tensions qui traversent le GPRA. G. Pervillé rappelle la démission, le 27 juin, de cinq membres du FLN de l’Exécutif provisoire pour protester contre la non-application des accords d’Evian concernant les enlèvements et les exactions touchant les Européens et protester contre l’anarchie qui s’installait en Algérie. Il publie des extraits du programme de Tripoli du GPRA du 7 juin 1962 estimant que les programmes de coopération des accords d’Evian établissaient des liens de dépendance « néocoloniale » dans les domaines économiques et culturels avec la France et qui s’opposent à toute présence d’Européens en Algérie. Ainsi voit-on se dessiner, à la veille de l’indépendance en Algérie, au sein de la nouvelle élite algérienne une tendance marxisante francophobe et une tendance réaliste plus francophile souhaitant conserver des liens de coopération avec la France.
Une coopération franco-algérienne tumultueuse
Après l’indépendance, la France continue à assurer le fonctionnement financier du Trésor algérien jusqu’au 29 décembre 1962 et accorde une assistance dans les domaines de l’énergie, de l’enseignement et du développement économique d’un montant de 2,3 milliards de francs de 1962 à 1969. Des accords sont signés pour réguler l’immigration algérienne qui passée l’euphorie de l’indépendance cherche à gagner la France pour des raisons économiques. Les relations franco-algériennes après l’indépendance sont davantage influencées par des intérêts. Pour la France, il s’agit de préserver ses bases d’essais militaires chimiques et nucléaires et ses centres d’exploitation d’hydrocarbures au Sahara, ainsi que de maintenir son influence culturelle en Algérie. De son côté, l’Algérie souhaite conserver le plus longtemps possible l’aide financière française, assurer l’exportation de sa production viticole sur le marché français, permettre l’émigration de travail de ses compatriotes en France, s’approprier les biens vacants des Européens et nationaliser les hydrocarbures du Sahara, seule ressource financière importante de l’Algérie indépendante. La France n’ayant plus d’intérêt au Sahara après la nationalisation des hydrocarbures, l’Algérie ne dispose plus de moyens de pressions sur elle, les relations que l’Algérie voudrait à nouveau privilégier ne le sont plus dans les années 70.
L’arabisation de l’enseignement et l’islamisation de la société algérienne dans les années 70 par H. Boumedienne favorisent l’émergence d’une contestation sociale portée par un islam radical. Un premier maquis islamiste apparaît même en 1982 annonçant 10 ans à l’avance la guerre civile algérienne. En 1991-1992, le régime Chadli impopulaire subit les contrecoups de la chute des prix du pétrole et l’échec électoral face au parti islamiste du Front islamique du salut. G. Pervillé évoque les arguments faisant le parallèle ou non entre la décennie noire de la guerre civile algérienne appelée également « la deuxième guerre d’Algérie » (1990-2000) et la guerre d’indépendance (1954-1962). Il interprète ce retour à la violence par un refus des autorités algériennes, pendant 30 ans, de faire un travail critique sur l’usage délibéré de la violence dans leurs luttes pour l’indépendance, reprenant l’autocritique de M. Harbi, acteur de l’indépendance et historien du FLN, évoquant « l’échec d’une génération n’ayant pas su trouver les chemins de la liberté ».
Un ouvrage pour favoriser une meilleure compréhension de notre histoire commune
Cette « génération finissante », selon les mots d’A. Bouteflika au pouvoir depuis 1999, laisse enfin la place à une nouvelle génération d’Algériens qui trouvera dans cet ouvrage les clefs de compréhension de son passé, histoire indispensable à connaître pour procéder à une nouvelle étape de la réconciliation franco-algérienne. Cet ouvrage dense et passionnant donnera également des connaissances actualisées aux professeurs d’histoire-géographie de lycée préparant leurs élèves pour le programme de « Questions pour comprendre le vingtième siècle » de classe de Première ES/L/S sur l’histoire de la guerre d’Algérie ou le programme de Terminale ES/L/S sur « L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie ».
Gregor Mathias
-Et ce compte rendu par Georges-Pierre Hourant qui est paru dans le n° 152, décembre 2015, de la revue L’Algérianiste, pp. 109-111 :
"Guy Pervillé, professeur émérite d’histoire contemporaine, travaille depuis plus de quarante ans sur la guerre d’Algérie et les relations franco-algériennes. Il participe souvent aux Congrès du Cercle algérianiste, et plusieurs de ses ouvrages ont fait l’objet de recensions ou d’essais critiques dans notre revue (n° 136,146,150...).
Son dernier livre, « Les Accords d’Evian », publié fin 2012, se présente comme un manuel approprié aux étudiants en sciences politiques, mais aussi à tous les lecteurs férus d’histoire. Ecrit avec sobriété et clarté, il est complété par une biographie des personnages cités, et une bibliographie chronologique et thématique ; de plus, chaque chapitre est suivi de documents tels que manifestes, décrets, débats, articles de presse, ou extraits de sites internet. En historien réputé pour son impartialité, l’auteur apporte avec prudence ses propres conclusions en prenant en compte toutes les sources disponibles, y compris nos propres publications ou auteurs, trop souvent oubliés par les tenants du « politiquement correct » (J.J. Jordi, M. Faivre, J. Monneret, R. Vétillard...). Dans cet ouvrage, Guy Pervillé repense l’histoire de la guerre d’Algérie en « considérant que la mémoire est un phénomène aussi important que l’histoire ». Il démontre donc que les accords d’Evian ne sont pas seulement un point d’arrivée, comme on le pense généralement, mais qu’ils expliquent aussi, jusqu’à nos jours, les relations entre les deux Etats, restées conflictuelles, car viciées dès le départ par des interprétations divergentes. Ainsi, l’étude qu’il nous propose est sans équivalent par son ampleur explicative.
Après avoir évoqué la genèse du nationalisme algérien, stimulé par le débarquement anglo-américain de 1942, et par l’inefficacité du statut des indigènes proposé par De Gaulle en mars 1944, l’auteur nous montre comment les dirigeants de la IV ème République passent de l’idée d’assimilation, encore en vigueur au début de la rébellion, à celle de fédération interne, tout en ayant des contacts secrets avec le FLN. Puis le lecteur peut constater l’incroyable cynisme de De Gaulle, qui déclarait ouvertement en privé, avant 1958, être favorable à l’indépendance algérienne, pour laisser penser en public le contraire quand il revient au pouvoir grâce aux partisans de l’Algérie française... C’est le début d’un malentendu aux conséquences désastreuses : de juin 1958 à septembre 1959, De Gaulle apporte « de nombreuses retouches, d’abord à peine perceptibles » à la politique d’intégration « sur laquelle il semblait s’engager », et refuse au général Challe « une victoire militaire trop complète qui aurait pu faire oublier la nécessité »,selon lui, « d’une solution politique ». Puis, du discours sur l’autodétermination (16 septembre 1959) au référendum du 8 janvier 1961, il tente de réaliser une politique « radicalement différente », qui le conduit de « l’Algérie algérienne » à la « République algérienne », en passant par la « mystérieuse affaire Si Salah », sur laquelle l’auteur « tente de faire le point ». Ensuite, par le référendum du 8 janvier 1961, approuvant l’autodétermination, De Gaulle « se donnait les moyens d’organiser lui-même le futur Etat algérien », mais, « dès le lendemain, il prit une autre voie, celle d’une solution directement négociée avec la direction extérieure du FLN ».
L’auteur détaille de façon exhaustive les étapes de ces négociations, avant de montrer comment les accords d’Evian, auxquelles elles aboutissent, n’étaient qu’un « fragile échafaudage juridique considéré par le gouvernement français comme « un programme commun proposé à la ratification de deux peuples », mais tenu au contraire par le GPRA pour un « traité de paix entre deux gouvernements ». De plus, leur application « sombra très vite dans le chaos », ce dont l’auteur rend responsables leur « sabotage par l’OAS », mais aussi leur « contournement par le FLN » (dissensions entre factions, enlèvements d’Européens, massacre d’Oran le 5 juillet) et De Gaulle lui-même « très lent à ouvrir les yeux sur l’exode massif des Européens, et indifférent au sort des harkis. Encore au pouvoir pendant 7 ans, il « continue à diriger personnellement sa politique algérienne », s’opposant par principe à toute révision des accords d’Evian, mais les laissant en réalité se vider de leur substance, « s’opposant aux demandes d’intervention de l’armée pour aller protéger les Français menacés », mais comblant les déficits du budget algérien, aussi bien sous Ben Bella que sous les débuts de la présidence Boumedienne. Le lecteur constate qu’il n’avait d’intérêt que pour les essais des armes chimiques et nucléaires au Sahara, et pour la nécessité de limiter l’immigration algérienne en France, devenue explosive après l’indépendance.
Après le départ de De Gaulle et la nationalisation des hydrocarbures algériens, les accords d’Evian pèsent encore sur les relations franco-algériennes, « entre ruptures et rapprochements (1969-1991) », puis pendant la guerre civile algérienne (1992-1999). L’auteur étudie de façon très approfondie les ressemblances et les différences entre « les deux guerres d’Algérie » ; il interprète ce retour de la violence comme un refus des autorités algériennes, pendant 30 ans, de « faire un travail critique sur l’usage délibéré de la violence dans leur lutte pour l’indépendance ». Il montre qu’entre la France et l’Algérie, le « rendez-vous manqué » persiste sous Bouteflika, avec « la revendication de repentance adressée à la France », entraînant l’échec du traité d’amitié souhaité par Chirac. En conclusion, il se montre sceptique sur les conditions d’une vraie réconciliation, en soulignant que « le 19 mars 1962 n’est pas une date commémorable de notre histoire », en constatant « l’enracinement des thèmes de propagande du FLN » en Algérie, où la vieille propagande francophobe est toujours instrumentalisée par le pouvoir, et enfin en invitant, vœu sans doute bien utopique pour l’instant, « ses dirigeants, ses militants, et ses citoyens à reconsidérer leur héritage historique avec esprit critique ».
Pour nous, en tout cas, cet ouvrage a le mérite de relier, par le fil conducteur des funestes accords d‘Evian, les événements tragiques que nous avons vécus, en tant qu’acteurs ou que témoins, à l’actualité qui est la nôtre aujourd’hui en tant que « rapatriés ». Car, pour nous aussi, comme pour les historiens, notre présent s’explique par notre passé, toujours vivant, toujours brûlant."
-Et encore celui de Maurice Vaïsse dans la Revue d’histoire diplomatique, 2015, n° 4, p. 378 :
"Le titre de ce livre de doit pas tromper le lecteur. Il y a en effet trois livres dans cet ouvrage ambitieux : il analyse certes les négociations et les accords d’Evian avec l’acuité intellectuelle de Guy Pervillé, mais il va beaucoup plus loin.
La première partie porte sur la période de la naissance du nationalisme algérien et de la Toussaint rouge au début des conversations avec le FLN. La deuxième partie est consacrée aux négociations et aux accords, ce qui a déjà été l’objet de l’ouvrage Vers la paix en Algérie ? qui reprenait nos Documents diplomatiques français, et de celui de Chantal Morelle, Comment De Gaulle et le FLN ont mis fin à la guerre d’Algérie. Mais la troisième partie couvre un demi-siècle de relations franco-algériennes de 1962 à 2012, et est un essai très maîtrisé de cette histoire bilatérale si heurtée. Il faut être reconnaissant à Guy Pervillé d’avoir osé couvrir cette période de 50 ans en cent pages limpides et documentées aux meilleures sources."
- A lire également mon interview par Roger Vétillard, publiée sur le site internet Metamag le 21 avril 2014 : http://metamag.fr/metamag-1984-Les-Accords-d’Evian-(1962)-Succes-ou-echec-de-la-reconciliation-franco-algerienne-(1954-2012).html, et sur mon site : http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3 ?id_article=324.
Et le point de vue d’un lecteur algérien, reçu en novembre 2022 : " Monsieur Pervillé, je viens de terminer une relecture de votre Les accords d’Évian, chez Armand Colin. J’y aurais séjourné longtemps. Votre livre est juste, au double sens de justice et de justesse. Mais on entrevoit qui vous n’aimez pas."